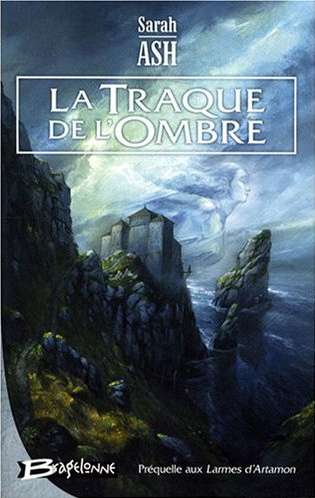Commençons cette critique en tirant un coup de chapeau à Bragelonne, qui publie cette traduction, à peine quelques mois après la parution en langue anglaise. Et encore, quelques mois… On pourrait presque dire quelques semaines !
On retrouve donc l’univers sympathique et élégant développé par Sarah Ash, non pas pour une suite à sa trilogie, mais une préquelle ! Une préquelle qui met en scène bon nombre des personnages vus précédemment, que ce soit dans leur jeunesse, ou bien après déjà plus de cent ans d’existence...
Après quelques pages de mise en route, on se laisse tout de suite happer par un récit parfaitement bien construit, au déroulement très classique, mais parsemé de petites touches d’originalité (notamment autour du personnage de Rieuk, qui au départ pourrait paraître bien agaçant, et qui va peu à peu devenir lui-même bien plus retors qu’on n’aurait pu l’imaginer de prime abord). Le deuxième tiers du roman constitue cependant une petite déception, avec toute une série de « nouveaux » personnages introduits à la suite, et un certain ralentissement des enjeux du fait de la poursuite de la mise en place de la série. Il permet toutefois de creuser un peu plus encore la question de la magie, habilement gérée et d’une logique à toute épreuve, de même que ce cadre justement, et cette Europe alternative. On aurait de fait pu craindre que le roman soit rattrapé là par sa nature : illustrer la jeunesse et la vengeance de Célestine de Joyeuse… cela demandait-il vraiment deux tomes ?
Mais le dernier tiers lève toute ambiguïté : parfaitement mené, entremêlant les différents fils de l’intrigue avec péripéties « feuilletonesques » et une certaine dose d’amertume, l’auteur justifie pleinement son choix de deux romans. La route de Célestine est encore longue, et assurément semée d’embûches...
Cette mise en perspective par rapport aux Larmes d’Artamon et notamment le rôle et la place de la Francia nous offrent un nouvel angle de lecture et démontrent un amour sincère de Sarah Ash pour notre beau pays, et surtout sa littérature… Évidemment, on pense bien sûr à Alexandre Dumas, ce qui ne manquera pas de plaire à son éditeur, qui le cite d’ailleurs en quatrième de couverture.
Le tout sans oublier une touche toute anglaise quant à la sensibilité – et non pas sensiblerie – des personnages féminins et aux tourments intérieurs de ses personnages, dominés par la figure toujours aussi inquiétante, et réussie, de Kaspar Linnaius, le genre de protagoniste que l’on adore détester.
— Gillossen